

Marie de Hennezel Vieillir est une chance
Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute, écrivaine,s’investit depuis de nombreuses années dans la considération de la vieillesse. Elle a travaillé pendant dix ans dans la première


Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute, écrivaine,s’investit depuis de nombreuses années dans la considération de la vieillesse. Elle a travaillé pendant dix ans dans la première


Rencontre avec le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine Michel-Marie Zanotti-Sorkine est un prêtre catholique, prédicateur, écrivain et auteur-compositeur-interprète. Au moment d’entrer au séminaire à l’âge de


Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l’École centrale Paris et habilité à diriger des recherches. Spécialiste de l’intelligence artificielle, ses


Votre livre Coups de sifflet nous apprend beaucoup sur la société grâce à vos recherches très précises sur l’évolution du football. Quel est le


Originaire du Brionnais, éperdu de liberté, Florian Gomet se définit comme un aventurier hygiéniste. Découvrant yoga et alimentation vivante, il a effectué trois premières mondiales.


Interview de Patricia Montaud réalisé par Émilie Poget, de l’association AGM Dans votre dernier livre, vous témoignez de toute la difficulté de rejoindre le sourire


Fabrice Jordan nous partage avec une grande transparence sa vision de la spiritualité, l’importance de l’engagement dans la voie et son rapport maître-élève. Un

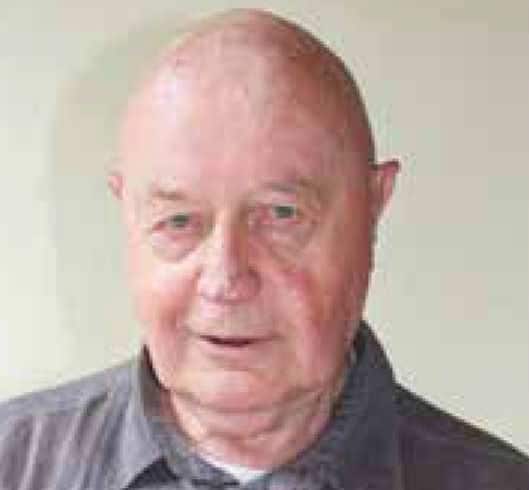
Nous vous avions rencontré ici même, il y a une dizaine d’années. Est-ce que votre enseignement évolue ? Oui. À condition que le verbe


Tu vis en permanence à la bergerie de Faucon maintenant ? Oui, pratiquement en permanence. Pourquoi je suis à la ferme ? Le 18 mars


RAFRAÎCHIR LA FOI Il y a 40 ans Bernard Montaud créait la voie spirituelle Artas pratiquant le dialogue inspiré transmis par Gitta Mallasz. Il
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.