
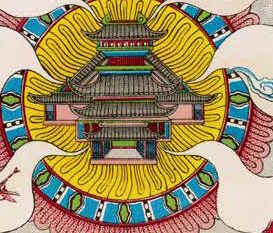
La menace nucléaire
La guerre en Ukraine a réactivé la menace de guerre nucléaire. Elle est aussi présente

Il y a bien longtemps, et c’est en partie oublié de nos jours, il y eût autour de l’an 300, c’est-à-dire il y a près de 17 siècles, un départ massif vers les déserts de Syrie, d’Arabie, de Palestine, de Gaza et d’Égypte d’une foule d’hommes et de femmes quittant ce qui était à l’époque l’empire romain. Que fuyaient-ils ? Ils ou elles s’en allaient déjà pour ne pas tomber dans le piège des formatages religieux qui s’institutionnalisaient de plus en plus. Ces formes ecclésiales, en cours de fixation, étaient appelés alors « La grande Église ». Et c’est dans ces déserts, à la fois hostiles et accueillants, que ces chrétiens de la marge posèrent leurs sandales dans des lieux qui, peu à peu, reçurent le nom de prairie des saints. Mais le désert qu’ils ou elles cherchaient était déjà profondément inscrits dans leurs ADN car il est omniprésent dans l’héritage judéo-chrétien.
À dire vrai, il est partout dans les différents passages de la Bible. Les anciens Hébreux passèrent quarante années en pérégrinations aléatoires dans le désert du Sinaï avec comme seul repère une colonne de fumée le jour et de feu la nuit qui les précédait. Les prophètes d’Israël, notamment Élie, cheminaient dans des étendues arides où ils ont cru, à plusieurs reprises, mourir. Le Christ, à divers moments de son existence terrestre se retirait lui aussi dans le désert.
Bien sûr, ces récits sont en partie allégoriques ou symboliques et s’adressent à toutes les époques sur un plan personnel ou collectif donc à nos contemporains c’est-à-dire nous-mêmes.
Peut-on dire qu’ils ou elles étaient « ivres de Dieu »
comme l’écrivait Jacques Lacarrière (1925-2005) ? Dans les nombreux écrits qu’ils nous ont laissés, le propos est plutôt excessif car ils étaient, le plus souvent, des paysans coptes (l’ancien nom des derniers Égyptiens antiques avant l’invasion arabe de l’an 641). Ils avaient donc, le plus souvent, un solide bon sens doublé d’une grande humilité car totalement hermétiques aux illusions du monde. Leur horizon était le désert ou la ruralité. Et l’on passe très vite de l’un à l’autre car la bande verdoyante qui suit le Nil est d’une très faible largeur. Leurs paroles, aussi rares que profondes, furent plus tard mises en forme dans un ouvrage dont le titre lui-même énonce l’ampleur de leurs témoignages. Il s’appelle en effet la Philocalie c’est-à-dire en grec l’amour de la Beauté. Ce qui veut tout dire !
Lui aussi était un paysan copte qui fut un jour, en passant devant l’une des premières églises, retourné par l’écoute d’un verset de l’Évangile. Il s’enferma ensuite durant près de vingt ans dans une tombe pharaonique pour arriver à l’éradication de ses démons intérieurs. Puis, d’après des sources bien documentées, il s’en alla vivre seul dans le désert. Ses paroles et son témoignage sont le socle de près de dix-sept siècles de spiritualité dont nous héritons, en Orient comme en Occident. Un Romain d’Occident, Jean Cassien (360-435), passa quelques années dans l’entourage de ces anciens qui prirent la suite d’Antoine et en recueillit leurs propos qu’il appela Les collations. Elles connurent un succès immense dans toute l’Europe et sont à l’origine du développement de tous les monastères.
À la fois très lointaine et éminemment contemporaine,
cette expérience consistait avant tout à trouver en eux et dans les autres leur vraie nature en tant qu’être humain. Pour se faire, ils devaient abandonner tous les « moi » conventionnels et les images sociales qui ne sont en réalités que des idoles vides de sens. Que ce constat est d’une brûlante actualité à l’heure de la communication virtuelle, numérique et mondialisée !
qui pourrait être pour nous aujourd’hui des repères ou des balises de vie ? Nous en évoquons ci-après quelques-uns…
– Comment accéder à notre réalité intérieure ? Ou encore savons-nous qui sommes-nous réellement ? Prenons-nous le temps, seul ou avec un accompagnement, pour faire cette auto-analyse ou pratique du discernement pour avancer sans notre vie ?
– Le repos était et reste, encore plus maintenant, une étape indispensable. Apprendre à s’arrêter quelques minutes dans la journée ou encore prendre un jour ou deux dans notre année pour faire le point dans les vacarmes ambiants qui nous rendent sourds à nous-mêmes.
– Entrer dans l’amour et la bienveillance. Les ermites parlaient peu ou alors de façons très imagée et concrète. Bien sûr, leur foi et leur confiance étaient ancrées en Jésus-Christ mais s’incarnaient réellement sur l’accueil et l’écoute des autres. N’est-ce pas là une leçon pour notre aujourd’hui pétri de jugements sur les uns ou sur les autres ?
– Au centre de cette vie en retrait se trouvait, et se trouve encore plus désormais, l’ouverture du cœur profond pour Dieu d’abord et pour les hommes et les femmes qui nous entourent… C’est sans doute cette ouverture du cœur qui rendra meilleur notre monde troublé et saturé de violences. L’étrange analogie avec les sages indouistes et bouddhistes se fait alors jour avec la sagesse du désert de l’héritage chrétien. Comme le soulignait Thomas Merton, que nous avons plusieurs fois évoqué dans cette chronique, l’avenir de notre humanité passera peut-être par la rencontre entre les diverses spiritualités peuplant ce monde dans ce qu’elles ont de commun dans leur rencontre, la montée vers un monde nouveau illuminé par un unique soleil. Et sous un nom ou sous un autre on verra s’amorcer une introspection, une pacification intérieure, une sorte d’évangélisation des profondeurs.
Gérard-Emmanuel Fomerand
Si cet article vous plait, pensez à faire un don. Le fonctionnement du site a un coût. Il n’y a pas de publicité.
Vous avez un bouton « don » sur le côté. Merci de votre participation quel que soit le montant

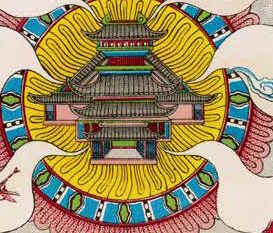
La guerre en Ukraine a réactivé la menace de guerre nucléaire. Elle est aussi présente


Ce samedi 8 juin a pris des couleurs d’automne quand nous arrivons au beau milieu


La Nouvelle-Calédonie, c’est loin. Loin de la métropole mais proche des causes qui donnent les
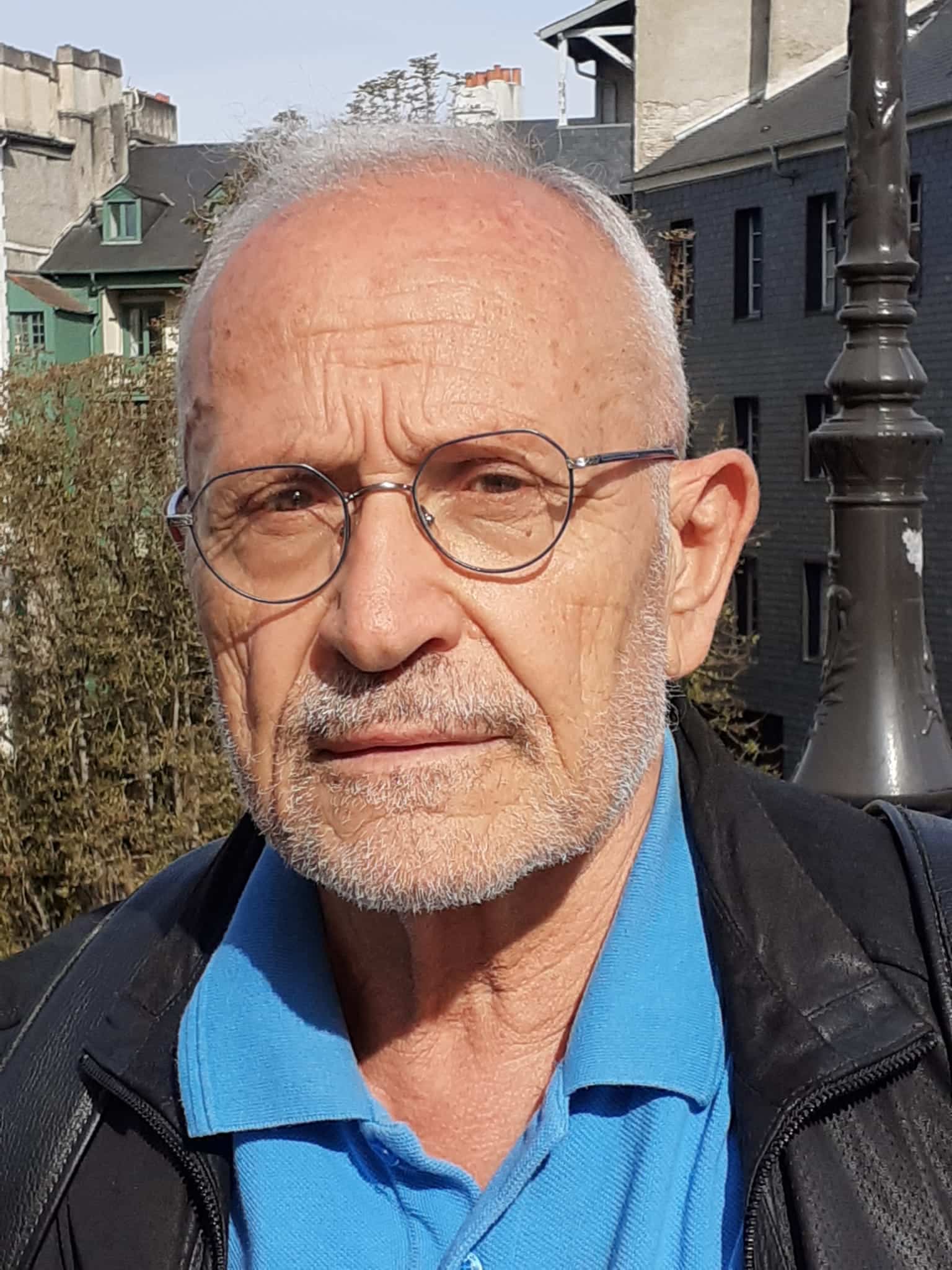
Gérard-Emmanuel Fomerand est analyste du phénomène chrétien. Il le réalise a travers des livres et des émissions de radios. Il développe actuellement un essai d’introspection de l’inconscient collectif occidental du christianisme, à travers ses réussites, ses échecs et sa modernité.
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.
Cet article a 2 commentaires
Merci de cet encouragement à chercher dans nos déserts, le territoire de Paix et de Bien d’une “oasis d’humanité” où il fait bon être…
merci Gabriele de ce commentaire qui arrive sur le site….la chronique suivante continuera le texte en traitant en avril l’évangélisation des profondeurs….quels que soient nos ombres et lumières, nous sommes tous et toutes participants à la nature divine dans cette divinisation de l’être humain évoqué par les Pères de l’orthodoxie et par certains mystiques occidentaux….sans fusion ni confusion