
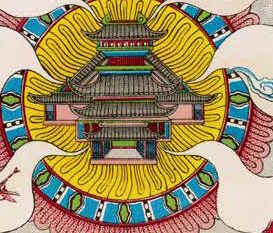
La place du populisme
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne
Jérôme Bultel
Jérôme Bultel est praticien hospitalier, médecin chef de service, gériatre à l’Hôpital de Vernon (Eure).
Trois milliards et demi d’euros en moins sur trois ans pour les hôpitaux. Suite à des années de restrictions budgétaires, les hôpitaux doivent encore se serrer la ceinture. Et cette coupe réglée se passe quasiment à l’insu des usagers qui, pour l’instant, ont intégré le discours officiel : si les hôpitaux sont en déficit, c’est qu’ils sont mal gérés. Par ailleurs, ils persistent à penser que nos hôpitaux français sont parmi les meilleurs mondiaux.
Or de nombreux lits sont supprimés, la souffrance des personnels dans leur travail est maintenant patente. Si beaucoup de syndicats se sont groupés lors de la grève du 8 novembre dernier, ce n’est pas un hasard. Un tel regroupement ne s’était pas vu depuis longtemps.
En fait, ce que les usagers ignorent, c’est que ce rationnement est organisé par l’État car tous les leviers financiers sont dans les mains des ARS (agences régionales de santé), elles-mêmes aux ordres du ministère de la Santé (et du budget). Le directeur n’a quasiment aucune marge de manœuvre. Il est devenu un simple exécutant des consignes de l’ARS.
Deux mots pour comprendre le principal financement des hôpitaux : la T2A (Tarification A l’Activité). L’État a mis en place un découpage des activités de soins (ceux qui s’y prêtent, essentiellement les soins techniques) et leur a attribué un tarif. Les hôpitaux (et les cliniques privées) doivent compter sur ces tarifs pour établir leur budget. Le soin relationnel, pourtant si fondamental, est laissé pour compte. Chaque acteur de soin gère ce temps relationnel comme il peut, sachant qu’il ne rapportera rien à l’établissement. Les ARS ont dit aux hôpitaux : augmentez l’activité, vous réduirez votre déficit. Beaucoup d’hôpitaux ont joué le jeu mais les ARS ont maintenant sifflé la fin de la partie. Elles jouent désormais sur deux tableaux : diminution des tarifs et réduction des effectifs. En effet, la T2A s’est révélée un véritable leurre car, devant l’augmentation d’activité mise en place par les acteurs pour réduire le déficit, les ARS annoncent qu’en raison des contraintes budgétaires (l’enveloppe qui leur est allouée est fermée) les tarifs T2A vont baisser, cette année encore, de 1 % ; ce qui veut dire que pour une même activité (mêmes nombres d’actes, même nombre de séjours etc.), les recettes de l’hôpital sont réduites d’autorité de 1 %.
Le deuxième volet, récent mais très alarmant, c’est la réduction du personnel. En effet, geler les grilles de salaires, mutualiser les achats, regrouper des services, toutes ces réformes sont déjà faites et atteignent leur limite. Ce sont les salaires qui coûtent cher, il faut donc s’en prendre aux ressources humaines. Il faut diminuer la masse salariale, mais en toute discrétion (grâce notamment à la multitude de contrats précaires, facilement révocables, mis en place par la politique frileuse de ces dernières années), par le non-remplacement des départs, par la « mutualisation », c’est-à-dire demander à ceux qui restent de faire, en plus de leur travail, celui de ceux qui sont partis.
Le vocabulaire des discours officiels est d’ailleurs consternant d’hypocrisie, formulée dans la langue du « politiquement correct » : optimisation, plan de performance, efficience, mutualisation, modernisation, pour finalement ne désigner qu’une seule réalité : gérer la pénurie.
Des soins trop rapides, réalisés par un personnel épuisé, deviennent de médiocre qualité. Mais les soignants ne peuvent même pas invoquer la nécessité d’une prise en charge « de qualité » et de « sécurité des soins » (démarche obligatoire très louable mais très chronophage et non budgétée) pour demander davantage de personnel, car cet argument peut se retourner contre eux. En effet il peut alimenter le cynisme des décideurs et leur rouleau compresseur sur la casse du service public de santé. Certains affirment, la main sur le cœur : il vaut mieux moins d’hôpitaux plus sécures que trop d’hôpitaux insécures. Il faut donc fermer des services et si possible des hôpitaux.
L’informatisation généralisée des soins, loin d’être un gain de temps, demande une présence énorme sur l’ordinateur. Tous les patients le constatent : les infirmières sont plus souvent sur leur écran qu’au lit du malade, sacrifiant leur temps à la « traçabilité ». Ces injonctions paradoxales – faire plus et mieux avec moins – rendent les soignants vraiment malades. Cela tourne à une maltraitance organisée. Ce constat est vrai aussi pour les maisons de retraite publiques (EHPAD publics) où les soignants n’en peuvent plus.
On a déjà « optimisé » presque tout de qui pouvait l’être. Le ministère a créé récemment les Groupement hospitalier de territoire (GHT), pour, dit-il, « fluidiser » le parcours du patient et rendre l’accès aux soins plus égalitaire. Pour les médecins c’est en fait une mutualisation supplémentaire : ils seront priés de consulter aussi dans les hôpitaux voisins, tout cela pour éviter de nouvelles embauches.
Finalement à l’hôpital, les directeurs ne peuvent envisager aucun investissement nouveau, sauf les travaux de mise aux normes que voudront bien financer les ARS. Leur vision est seulement celle de leurs tableaux trimestriels, car ils ont deux à trois ans pour prouver qu’ils peuvent mettre en place des économies drastiques. Aucune vision de leur hôpital dans 10 ans n’est possible.
Alors que faire ? Les acteurs et les usagers doivent se réveiller avant qu’une anesthésie très progressive ne les tue. Rétablir aussi de la démocratie, car elle a largement abandonné le domaine de la santé depuis plusieurs années.
En 1996 les ordonnances « Juppé » et la loi de financement ont aligné les dépenses de santé sur le modèle des autres dépenses budgétaires. L’enveloppe nationale est fixée chaque année par les députés : c’est l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), budget qui finance aussi les hôpitaux et distribue à chaque ARS sa quote-part, enveloppe fermée qui ne peut être dépassée. Depuis plusieurs années le taux d’augmentation de l’ONDAM est très souvent inférieur à l’inflation.
Mais la législation la plus délétère, et de loin, pour les hôpitaux est assurément la loi HPST, dite loi Bachelot. Créée pour « moderniser » l’hôpital, mettre en place un « vrai patron », selon les mots de Nicolas Sarkozy, pour le gérer « comme une entreprise » cette loi a été promulguée en 2009. Au-delà de ces intentions, mensongères pour les raisons expliquées plus haut, faisant croire qu’un hôpital peut être « rentable », elle a considérablement diminué la démocratie à l’hôpital. Les instances n’ont plus aucun pouvoir. Le conseil d’administration a été remplacé par un conseil de surveillance, où les élus, les médecins, les syndicats sont peu représentés, et n’ont qu’un seul pouvoir, celui de mécontenter le directeur et l’ARS, quand ce conseil s’oppose aux injonctions budgétaires, car l’ARS fera quand même ce qu’elle avait prévu. (cf. l’hôpital de Lavaur). Même chose pour les autres instances, la Commission médicale d’établissement (CME), le Comité technique d’établissement (CTE), que beaucoup de membres désertent car leur présence ne change rien.
Marisol Touraine a persisté dans cette politique de coups de rabot et n’a pas rétabli davantage de démocratie. Elle a commandé le rapport Couty qui, en 2013, voulait ce rétablissement, mais il a été enterré.
En février dernier, écœuré, Thomas Dietrich a démissionné avec fracas de son poste de secrétaire de la Conférence nationale de santé (CNS), instance consultative ouverte aux patients, pour dénoncer la « vaste mascarade » que constitue selon lui la « démocratie en santé ».
Or il faut affirmer haut et fort que les soins aux malades n’ont pas vocation à être rentables financièrement, même si chacun est d’accord pour que chaque dépense soit gérée au mieux, avec pertinence et économie.
Je ne suis pas économiste mais je vois, de là où je suis, le désastre humain que ces coupes claires répétées, de droite ou de gauche, entraînent, et je sais que la « santé » de l’économie ne peut justifier tous ces reculs. Le culte qui lui est rendu permet tous les reniements démocratiques (regardons les 49-3 récents.). Elle recouvre le politique jusqu’à l’étouffer. L’ogre financier devient un dieu monstrueux qui, tel Cronos, dévore ses enfants pour leur conserver un père.
A l’hôpital de Vernon où je travaille, des lignes de gardes sont supprimées, des services viennent de fermer alors que cette petite ville de 25 000 habitants est dans l’Eure. Ce département est particulièrement sinistré en matière de santé car il est le 90e département (ex-æquo avec la Guyane) pour le nombre de praticiens, de kinés et d’infirmières par habitant. Ici, les postes de soignants sont sacrifiés, mais pas les postes de sous-directions diverses et de « contrôleurs de gestion » qui, eux, se portent bien.
Tout se passe comme si les politiques publiques étaient en priorité au service de la dette, certes considérable. Cette dette est dite « souveraine », mais en réalité ce sont les financiers qui sont souverains. Les faillites des banques sont désormais protégées par les états.
Il est donc indispensable que les citoyens – tous tôt ou tard usagers des services de santé – soient informés de ces réalités, certes complexes, et se dressent pour arrêter cette machine infernale en marche sur le service public de santé depuis des années.
28 novembre 2016, Jérôme Bultel

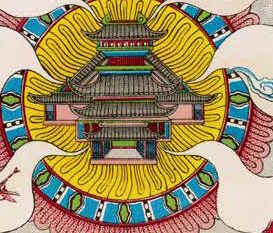
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne


Depuis trente ans, vous avez beaucoup parlé et écrit sur la crise de la


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.