
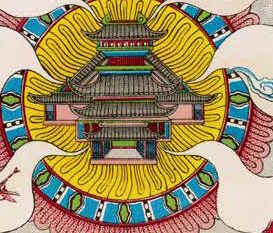
La menace nucléaire
La guerre en Ukraine a réactivé la menace de guerre nucléaire. Elle est aussi présente
Interview d’Élise Boghossian
Après des études en neurosciences, Élise Boghossian s’est formée à l’acupuncture et au traitement de la douleur en Chine et au Vietnam. En 2002, elle crée l’association Elisecare dont l’objectif est de promouvoir les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise. Petite-fille de rescapés du génocide des Arméniens en 1915, c’est en référence à son propre passé qu’elle a choisi de s’engager dans l’aide aux victimes de guerre, en faisant de l’acupuncture un instrument humanitaire. Elle intervient dans les zones de conflit apportant son aide aux populations meurtries, en Arménie d’abord, puis en Jordanie et en Irak. Après un premier dispensaire mobile et le « bus des femmes » parti en Irak en juin 2015, Élise Boghossian projette de créer de nouvelles unités mobiles en France et à l’étranger, dans les zones de guerre ou les milieux défavorisés. Elle témoigne de son expérience dans un livre Au royaume de l’espoir, il n’y a pas d’hiver ‒ Soigner en zone de guerre, paru fin 2015 aux éditions Robert Laffont, dont les droits sont reversés à son association Elisecare pour financer ses dispensaires mobiles et la création d’un hôpital en Irak.
www.elisecare.org
« J’ai rempli ma vie de rêves, dont celui d’apaiser la souffrance des autres », dit Élise Boghossian. Mère de trois enfants, cette jeune femme déterminée quitte une fois par mois son cabinet d’acupuncture parisien pour soigner avec ses aiguilles les réfugiés syriens et irakiens exilés au Kurdistan. Sur place, elle forme des équipes médicales et elle lève des fonds en France pour créer des dispensaires mobiles allant à la rencontre de ceux qui souffrent, au plus près des situations d’urgence.
Au début de votre ouvrage, vous posez une question sans donner de réponse : « Est-ce que je suis dans l’humanitaire ou est-ce que je fais partie de cette humanité ? » Aujourd’hui, que répondriez-vous à cette question ?
Je me pose encore la question. Le terrain apporte certaines réponses, mais la remise en question est toujours là. Lorsque l’on fait de l’humanitaire… on apporte ses conceptions, ses idées, avec l’impression d’être mieux placée pour désigner à des populations leurs besoins. Et les réalités que l’on découvre sur place n’ont parfois rien à voir avec ce que nous pensions être une urgence fondamentale. Ce qui est difficile, c’est que l’on peut être amené à créer des besoins qui ne sont pas indispensables et qui engendrent de la dépendance, un sentiment de dette. Et de plus, le jour où on n’est plus là, on laisse ces personnes complètement livrées à elles-mêmes.
Ce qui est important est de pouvoir apporter une aide concrète, de transmettre ce que l’on sait, pour les aider à devenir autonomes. C’est la seule solution pour aider ces gens à retrouver une vie normale.
Quand on fait de l’humanitaire, on peut se poser la question suivante : « Est-ce que je fais cela pour me donner bonne conscience ou pour aider réellement ? » Dans l’aide que j’apporte, que notre équipe apporte, nous pensons d’abord aux personnes déplacées, exilées, torturées, violées, maltraitées, oubliées. Nous essayons de les aider de manière utile et pérenne.
(…)
Parlez-nous de votre équipe et de son travail sur le terrain.
Seulement 9 % des réfugiés et des déplacés irakiens ont pu s’installer dans des camps de réfugiés, eux-mêmes déjà saturés par les réfugiés syriens de la guerre civile qui a débuté en 2011. Les 91 % restants sont dispersés dans tout le Kurdistan et n’ont pas accès aux structures d’aide mises en place par la communauté internationale. C’est pour répondre à leurs besoins que le premier dispensaire mobile a été créé en janvier 2015. L’équipe de ce bus, composée de sept médecins et de personnels soignants, eux-mêmes réfugiés, dispense consultations et soins spécifiques aux femmes et à leurs enfants : gynécologie, suivi de grossesse, soins postpartum, néo-natalité, pédiatrie, traitement de la douleur… Le bus dispose à son bord d’une pharmacie qui distribue les médicaments. Des psychologues assurent un soutien psychologique durable aux femmes traumatisées, en collaboration avec des organisations locales. Ils contribuent à la réinsertion de ces femmes qui vivent souvent en marge de la société. Les enfants font également l’objet d’un suivi dans le cadre d’ateliers créatifs favorisant l’expression de leurs traumatismes sous des formes non verbales.
(…)
Dans votre livre, que voulez-vous dire par « La religion doit être l’expression de la spiritualité » ?
Sommes-nous condamnés à faire de cette planète un lieu de destruction et de souffrance ? Nous sommes tous reliés, nous faisons tous partie du même monde, et la plupart des guerres sont des guerres de religion. Elles sont le fruit de haine, de non-respect de nos différences, elles puisent leur feu dans l’ignorance. Mon moteur, est-ce la foi ? Je ne sais pas. Je crois plutôt que tout mon être est animé par l’engagement. Aujourd’hui en Occident, nous sommes devant une génération de personnes poussées par une soif de consommation et continuellement insatisfaite. Se disent-ils heureux ? Nous cherchons tous à donner du sens à nos actions, une voie pour nous engager et nous épanouir. Ce qui fait notre force, ce qui renforce notre identité, notre ancrage à la terre, ce que nous sommes appelés à être et à devenir, c’est une relation quasi spirituelle à la vie, et donc à la mort, à notre propre mort.
(…)
Ma foi se manifeste au niveau de l’engagement. Pour ce qui est de la spiritualité, j’ai fait mes études en Asie, nous sommes faits d’énergie, c’est l’énergie qui engendre la vie, c’est l’énergie qui nous lie aux autres. Cette énergie a une part visible et une part d’invisible, et ce qui nous unit est aussi bien le visible que l’invisible. Le concept de l’énergie est fondamental dans la philosophie taoïste. J’ai été baptisée, je suis arménienne, c’est annexe, je pense. La foi que j’ai dans mon travail, dans mon équipe, dans mes rêves, est avant tout propulsée par mon désir d’engagement, ma sincérité par rapport à ce que je fais, ma relation aux autres.
Votre expérience vous permet-elle de dire que vous avez moins peur de votre vieillesse et de votre mort ?
Quand on touche la vie dans son extrême, la souffrance dans son extrême, la mort, on développe peut-être aussi une forme de détachement pour vivre l’instant présent, savourer des bonheurs simples. Sur le terrain et avec les personnes que je soigne, j’apprends que le plus important n’est pas de se donner des recettes de bonheur pour objectif de vie. Quand du jour au lendemain, en l’espace de quelques heures, on a tout perdu, on s’accroche à ce qui est essentiel, c’est-à-dire la vie. Et quand nous en sommes les témoins, même si nous ne sommes là que pour soigner ces personnes, nous nous demandons si nous serions, nous, capables d’encaisser des souffrances similaires.
(…)
Ces situations extrêmes contribuent-elles à vous rendre meilleure ?
Avec toute notre équipe, nous essayons d’être justes. Nous recrutons des médecins hommes et femmes parmi les réfugiés sans distinction religieuse. Ils soignent les réfugiés dans le respect de l’autre, dans une relation d’égalité. À chaque retour de mission, je suis bouleversée par ce que j’ai vu et entendu. Je travaille beaucoup pour mener cette petite barque parce que nous sommes une petite organisation. Parce que le travail ne finit jamais, parce que l’on ne voit pas le bout du travail. En même temps, c’est incroyablement passionnant, excitant, de mettre son temps et son énergie dans des causes fondamentales. On trouve en soi des ressources tout le temps, on devient plus fort, et meilleur aussi.
Pour lire l’article en entier, Reflets n° 21 pages 18 à 20

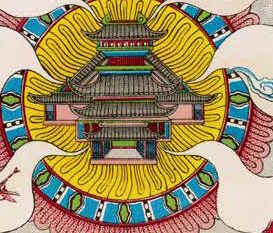
La guerre en Ukraine a réactivé la menace de guerre nucléaire. Elle est aussi présente


Ce samedi 8 juin a pris des couleurs d’automne quand nous arrivons au beau milieu


La Nouvelle-Calédonie, c’est loin. Loin de la métropole mais proche des causes qui donnent les
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.