
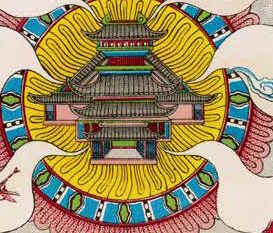
La place du populisme
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne
selon Jacques Lusseryran
Comment évaluer l’importance de l’art ? L’art est-il un luxe ou une nécessité pour l’être humain ? Que nous dit la fréquentation des œuvres d’art ? L’art véritable, fruit de la contemplation des artistes créateurs qui nous ont précédés, nous touche au plus profond et stimule, lorsque nous y sommes attentifs, notre propre contemplation et l’intuition d’un possible nouveau. Mais il est des expériences extrêmes qui révèlent l’importance vitale et existentielle de toute forme d’art pour l’homme qui le crée et pour celui qui s’en rassasie.
Le témoignage que nous livre Jacques Lusseyran dans son livre autobiographique Le monde commence aujourd’hui traduit cette vérité de la manière la plus crue. Il nous montre comment, dans le dénuement abyssal du camp de concentration de Buchenwald, la poésie a redonné vie et espoir à des hommes brisés par le froid, la faim, la terreur et la haine. C’est la poésie qui vient à leur secours à travers des bribes de mémoire réassemblées. Récitée comme une incantation, elle transforme les sensations du corps, fait circuler le sang, agit au plus profond de l’être. Elle nourrit l’âme et restitue le désir de vivre. En élevant ces hommes perdus au dessus de leur malheur individuel, elle leur redonne dignité humaine, les transporte ailleurs et leur fait goûter à l’universel jusqu’à leur permettre de transcender une réalité abjecte.
Mais laissons Jacques Lusseyran nous livrer le cœur de son expérience.
« Et je me mis à réciter des vers, au hasard, tous ceux que je retrouvais, tous ceux qui ressemblaient à notre vie en cet instant. Je récitai du Baudelaire, du Rimbaud, à voix simple.
(…)
Le cercle des hommes autour de moi se serrait : c’était une foule. Alors, j’entendis que ces hommes n’étaient pas des Français. L’écho des vers qu’ils me renvoyaient était parfois défiguré comme le son d’un violon dont une corde se relâche, parfois juste comme un diapason.
(…)
Il ne me restait en mémoire qu’un poème de Baudelaire : La Mort des Amants. Je le donnai. Et des dizaines de voix ronflantes, grinçantes, croassantes, caressantes répétèrent : « des flammes mortes »…
Je sais que c’est à peine croyable, mais, derrière moi, j’entendis des hommes qui pleuraient.(…)
Non la poésie, ce n’était pas de la littérature, pas seulement. Cela n’appartenait pas au monde des livres. Cela n’était pas fait pour ceux-là seuls qui lisent. Les preuves se multipliaient.
(…) Il était une chose que seule la terreur pouvait obtenir, c’était que ces centaines d’hommes bouillonnant au fond de la baraque fissent silence. Seule la terreur… et la poésie. Si quelqu’un récitait un poème, tous se taisaient, un à un comme des braises s’éteignent.
(…)
Un manteau d’humanité les recouvrait. J’apprenais que la poésie est un acte, une incantation, un baiser de paix, une médecine. J’apprenais que la poésie est une des rares, très rares choses au monde qui puisse l’emporter sur le froid et sur la haine. On ne m’avait pas appris cela.
(…)
Cependant tous les poètes ne se valaient pas.
(…)
Hugo lui, triomphait. Le moindre de ses vers agissait sur nous à la façon d’une poussée, d’un influx de sang. Ce diable d’homme, cet irrésistible vivant se mêlait de nos affaires dès qu’il prenait la parole (…) Il n’y avait point besoin pour nous de le comprendre, ni même de l’écouter exactement, d’écouter ses paroles : il suffisait de se laisser faire. (…)
Baudelaire aussi travaillait bien. Mais lui c’était comme à force de ruse : il avait le talent – si rare après tout – de dénicher au fond des trous les plus noirs la plus petite étincelle de lumière et de la faire éclater à nos yeux. Il donnait du prix aux embarras, aux effondrements de nos corps. Il reliait la terre au ciel, le réel et l’impossible, avec une adresse qui nous donnait du courage.
(…)
Mais les vrais gagnants, les toniques, ceux qui agissaient à la façon de l’alcool, massivement, c’étaient les chanteurs. J’en trouvais dans le Moyen-Age. Puis venaient Villon, Ronsard, Verlaine, Apollinaire, Aragon. Ceux-là déplaçaient tous les obstacles. Ils parlaient distinctement depuis un autre lieu que la terre. Ou plutôt, c’était leur pas, le rythme de leur marche, qui n’avait plus rien de commun avec notre façon à nous de ramper. Ils passaient en volant et nous posaient sur leurs ailes.
(…)
J’entends les sceptiques gronder : « Il ne nous fera pas croire qu’ils se nourrissaient de poésie. » Certes non : nous nous nourrissions de soupe à l’eau et d’un pain amer. Et d’espérance. Que les sceptiques ne l’oublient pas ! Or c’était justement avec l’espérance que la poésie avait affaire. Et il m’a fallu traverser ces circonstances épaisses, matérielles, étroitement physiques – jusqu’à la suffocation – pour savoir combien sont denses et tangibles ces choses sans poids qu’on nomme espoir, poésie, vie.
(…) Alimenter le désir de vivre, le faire flamber, cela seul comptait. Car c’était lui que la déportation menaçait de mort. Il fallait se rappeler sans cesse que c’est toujours l’âme qui meurt la première – même si son départ ne s’aperçoit pas – et qu’elle entraîne toujours le corps dans sa chute. C’était l’âme qu’il fallait nourrir en priorité.
La morale était impuissante.
(…)
Seule la religion nourrissait. Et tout près d’elle, la sensation de la chaleur humaine, de la présence des autres en tant qu’êtres physiques contre notre corps. Et la poésie.
La poésie chassait les hommes de leurs refuges ordinaires, qui sont des lieux pleins de dangers. Ces mauvais refuges, c’étaient les souvenirs du temps de la liberté, les histoires personnelles. La poésie faisait place nette.
(…)
C’est un peu parce que j’ai fait cette expérience que je dis et dirai sans me lasser : « L’homme se nourrit de l’invisible. Il se nourrit de l’impersonnel. Il meurt pour avoir préféré leurs contraires. »
Extraits de Le monde commence aujourd’hui, réédition aux éditions Silène, 2012. p. 86-96.
Pour lire l’article en entier, Reflets n° 20, pages 50 à 53
*************************************************************************

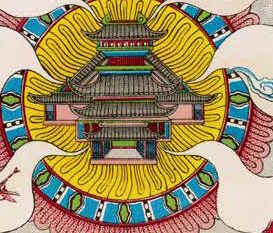
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne


Depuis trente ans, vous avez beaucoup parlé et écrit sur la crise de la


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.