
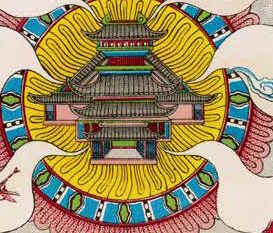
La place du populisme
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne
Pas au début, non. J’étais au contraire tout à fait anti stalinien. Je dirais plutôt gauchiste parce que je faisais partie des chercheurs selon la revue Esprit avec Emmanuel Mounier, Simone Weil. J’ai suivi un certain nombre de gens qui savaient qu’il y avait la grande crise du capitalisme économique et qu’il fallait aussi bien repousser la solution fasciste que la solution stalinienne. De plus, j’étais pacifiste, parce que ma génération subissait encore l’influence très puissante de celle qui avait vécu ou suivi la Première Guerre mondiale et qui disait : « Plus jamais ça ! » Ces gens-là étaient assez influents à gauche. J’ai dû faire une véritable conversion au communisme pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’Occupation.
En réalité, j’ai suivi un petit parti qui s’appelait le Parti frontiste dont la devise était de lutter sur deux fronts : contre le stalinisme et contre le fascisme. Quand la guerre est arrivée, ces recherches ont été anéanties. J’ai commencé alors à réfléchir. Je disais que s’épanouirait dans l’avenir une belle civilisation socialiste, communautaire. Mais dès que j’ai vu que ça ne serait pas le cas, j’ai rompu avec cette famille, douloureusement, car l’atmosphère y était très chaleureuse.
J’étais internationaliste – ce qui n’empêchait pas d’être patriote – avec l’idée de l’universel, que tous les peuples étaient respectables. Quand j’étais résistant, j’étais antinazi, mais je n’ai jamais fait la moindre traque anti allemande. J’avais donc cette idée d’humanité. Mon internationalisme communiste est resté vivant, même détaché du parti. Mais à partir des années 56, j’ai intégré cette idée d’ère planétaire, et au fur et à mesure – surtout après la chute de l’Union soviétique et la mondialisation dans les années 89, 90 – mon internationalisme est devenu davantage une conscience de communauté de destin humaine devant des périls énormes provoqués eux-mêmes par cette mondialisation, comme la dégradation de la biosphère. Je suis donc arrivé à l’idée de Terre-Patrie qui est l’aboutissement concret, enrichi de ce qui était au départ l’internationalisme avec cette notion d’unité et de multiplicité. En d’autres mots, la diversité humaine doit être autant respectée que l’unité humaine, que l’une est le trésor de l’autre et que, par là même, les nations doivent continuer à exister avec leur culture, sans avoir la souveraineté absolue pour les problèmes communs de l’humanité. C’est une notion presque permanente en moi, puisque, adolescent, j’allais déjà vers ces idéologies universalistes, vers l’humanisme – j’étais formé par Montaigne, Montesquieu –, mais elle s’est vraiment enrichie à la lumière de l’ère planétaire et de la mondialisation.
Pour lire l’article en entier, REFLETS n ° 34 pages 16 à 21

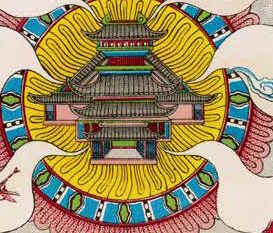
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne


Depuis trente ans, vous avez beaucoup parlé et écrit sur la crise de la


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.