
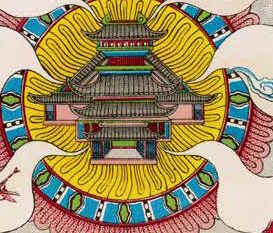
La place du populisme
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne
Jean-Claude GUILLEBAUD
Voyage au bout de la violence
Jean-Claude Guillebaud a été journaliste grand reporter à Sud Ouest, au Monde et au Nouvel Observateur où il tient aujourd’hui une chronique hebdomadaire. Après avoir été directeur littéraire au Seuil pendant plus de trente ans, il est actuellement directeur littéraire aux Arènes et à l’Iconoclaste.
Devenir un monstre du jour au lendemain… Tout être humain, même le plus doux d’entre nous, possède en lui un pire et un meilleur. Jean-Claude Guillebaud l’a expérimenté. À l’âge de 72 ans, il choisit de s’en délivrer en confiant son pire, vécu lors de ses reportages de guerre, dans son livre Le tourment de la guerre, éd. L’Iconoclaste, dont il aborde ici quelques thèmes.
Quelle était votre intention dans ce livre sur le tourment de la guerre ?
J’ai dédié ce livre à mon père et au philosophe René Girard qui a beaucoup compté dans ma vie. En 2007, lors de la promotion de son dernier ouvrage Achever Clausewitz, un livre d’entretiens sur le thème de la guerre, je lui avais dit : « J’ai un livre qui m’attend au tournant depuis plus de quinze ans. Il faut que j’écrive sur la guerre. Si j’y arrive, je te le dédierai. Et mon rêve serait d’arriver à mettre de la chair à tes analyses. »
Le tourment de la guerre, c’est d’abord un tourment personnel. Je suis né en 1944, j’ai donc 24 ans en mai 1968. J’appartiens à une génération plutôt antimilitariste qui n’a pas connu la guerre, il ne fallait pas y réfléchir, il fallait la condamner. En même temps, je vouais une grande admiration à mon père qui a eu une carrière militaire héroïque toute sa vie.
Mais c’est aussi un tourment collectif. Voilà soixante-dix ans que nous étions en paix. Quand j’étais étudiant, comme tout le monde, j’étais convaincu que l’état naturel d’une société, c’était la paix, et que la guerre était un archaïsme, une folie, qui allait disparaître. René Girard m’a beaucoup aidé à comprendre que c’était une erreur : l’état naturel d’une société, c’est la violence, qui est là, tout le temps, et qu’il s’agit de conjurer, de tenir à distance pour protéger la paix. Cette dernière est sans cesse à reconstruire, à restaurer.
En tant que correspondant pour Le Monde, pour Sud-Ouest puis Le Nouvel Observateur, j’ai vécu dans la guerre pendant 26 ans et j’avais des choses difficiles à dire, qui sont dans le livre et que, pour certaines d’entre elles, je n’avais jamais racontées auparavant.
On est toujours en train de râler contre nous, à se détester. C’est parce que nous ne nous aimons pas que cette violence s’exprime à l’extérieur et qu’elle devient collective ?
Bien sûr. Mais il y a aussi cette phrase magnifique de la philosophe Simone Weil : « Il faut avoir le courage de regarder les monstres qui sont en nous. » Cela veut dire que la violence n’est pas seulement chez l’autre, elle est aussi chez nous ; si on s’imagine que la violence c’est seulement l’autre, alors on est entraîné dans une logique exterminatrice car on finit par se convaincre que pour débarrasser le monde de la violence, il n’y a qu’à tuer l’autre !
En réalité, n’importe lequel d’entre nous est capable de devenir un monstre du jour au lendemain ; je l’ai vu, c’est l’enseignement de mon métier. Un ami libanais parle de cette espèce d’ivresse de la violence qui peut saisir le plus doux des humains : « Quand on dit qu’on va prendre les armes, pour dire qu’on entre en guerre, c’est une mauvaise expression. Il faudrait dire qu’on va être pris par les armes, c’est-à- dire que ce sont elles qui vont nous aspirer dans leur propre logique. »
Est-ce que le terrorisme manifesterait la différence de moyens ?
Le terrorisme existe depuis toujours. Ce qui est radicalement nouveau, c’est qu’il est désormais pratiqué par des gens que la mort indiffère, voire qui souhaitent mourir en martyr. Comment fait-on pour résister militairement à des jeunes qui sont prêts à mourir quand nous, Occidentaux, restons – à juste titre – attachés à la vie ?
(…)
Quand j’ai découvert la guerre notamment au Viêt Nam en 1969, j’ai réalisé que nous pouvions tous succomber à l’ivresse de la guerre. Comme mes confrères, j’ai accepté de faire les reportages « excitants » qu’on nous demandait, par exemple des bombardements en piquet derrière le pilote, ou – sanglé à côté du mitrailleur d’un hélicoptère de combat – de l’arrosage à la mitrailleuse lourde pour tuer tous ceux qui pouvaient préparer une embuscade. Or, je dois avouer que pendant quelques minutes, pour employer une expression vulgaire, j’ai « pris mon pied » comme un gosse. Et immédiatement après, j’ai eu honte de ce que j’avais ressenti. J’ai pris l’habitude d’appeler ça « les plaisirs dégoûtants ». Et tous mes confrères éprouvaient cela. Sans en parler.
J’ai essayé de creuser la question et je me suis aperçu que notre mémoire collective d’Européens est adossée à des siècles et des siècles durant lesquels la plupart des grands écrivains ont célébré la guerre : elle donnait à l’homme la possibilité d’aller jusqu’au bout de lui-même, elle lui permettait d’éprouver les amitiés les plus fortes, celles qu’on noue dans la bataille et face à la mort, de sentir la solidarité, l’héroïsme, l’amour et la fierté de soi. Nous avons oublié ces siècles de « célébration » de la guerre.
(…)
Quand j’étais étudiant, j’étais convaincu que nos sociétés allaient être gouvernées par la raison, la rationalité, le marché et que les croyances allaient disparaître de nos vies. J’avais oublié que la spiritualité fait partie de l’homme. C’est Edgar Morin qui m’a aidé à le comprendre parce qu’il a toujours écrit que la raison est un mode d’approche du réel très important mais que ce n’est pas le seul mode. Son livre Amour, poésie, sagesse le prouve ; ce sont trois choses que la raison est incapable de saisir. Je n’ai jamais oublié ça. Concernant le christianisme, deux personnes ont beaucoup compté dans ma vie : René Girard et Jacques Ellul, pasteur et grand théologien qui a écrit deux livres magnifiques : Contre les violents et L’espérance oubliée ; deux maîtres qui étaient tous deux non-violents, l’un catholique, l’autre protestant.
Aujourd’hui la sagesse, la méditation, la spiritualité reviennent en force. Je pense qu’on va voir des mutations étonnantes. On va voir la foi, au sens chrétien du terme, resurgir d’une manière complètement différente, beaucoup plus authentique et profonde. Si quelqu’un l’annonce, c’est bien le théologien Maurice Bellet, qui est devenu un ami.
Vous dites que vous adhérez à l’idée d’une mutation qui serait comparable à celle du néolithique ?
Oui et c’est Michel Serres qui a précisé mon idée. Il a expliqué que pour trouver une mutation aussi radicale, il fallait remonter au commencement de la révolution néolithique qui s’est écoulée sur plusieurs années, parce qu’il s’est passé trois choses en même temps fondamentales : les hommes ont cessé d’être chasseurs pour devenir éleveurs. Ils ont cessé d’être nomades pour devenir sédentaires et ils ont cessé d’être cueilleurs de fruits dans la forêt pour devenir agriculteurs. L’élevage, la sédentarité et l’agriculture enracinent notre rapport au territoire. Et qui dit territoire dit la cité, le vivre ensemble, les règles communes, et c’est le commencement de la civilisation. Et aujourd’hui, ce que les mutations postmodernes sont en train de réviser complètement, c’est précisément ce rapport au territoire. Nous devenons hors-sol. Quand vous êtes sur internet, vous êtes où ? Quelqu’un qui téléphone, dans le train, la première phrase qu’il dit c’est « je suis à tel endroit » ; il faut qu’on rappelle le lieu parce que le rapport à celui-ci est en train de s’effriter. Il en est de même pour le rapport au temps : lorsque vous discutez sur internet avec des gens qui sont ailleurs dans le monde, quelle heure est-il… ? On est en train de vivre des mutations profondes parce qu’elles touchent aux concepts mêmes qui nous permettent de réfléchir au monde et elles entraînent des conséquences.
(…)
Pour lire la suite Reflets n° 19 pages 77 à 80
*************************************************************************

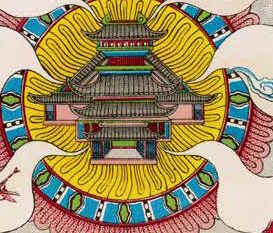
Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne


Depuis trente ans, vous avez beaucoup parlé et écrit sur la crise de la


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.