

Témoignage crise de la quarantaine …
Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au
Longtemps, j’ai cru que j’étais libre ; je me trompais et je ne le savais pas. Comme tout un chacun, je pensais qu’être libre consistait à se défaire de toute contrainte et à décider de sa vie. Subir un papa violent, autoritaire m’a très tôt conditionné à tout mettre en œuvre pour avoir le choix, ne sélectionner que ce qui me plaisait. Devenir professeur de lettres, puis psychanalyste verbal m’a convaincu que je contrôlais ma vie, que je parvenais enfin à exister, à obtenir une reconnaissance, de la valeur. Il est vrai que les élèves difficiles dont je m’occupais ainsi que mes patients m’obligeaient à ne rien laisser au hasard. J’avais beau être sur le qui-vive en permanence, pour autant, je cessais de m’identifier au personnage du « petit con » dans lequel mon père me cantonnait. Le choix professionnel me permettait de croire que n’avoir ni Dieu ni maître représentait le summum de la liberté.
Pourtant j’aidais de travers, j’aimais de travers, mais je l’ignorais. Deux événements déroutants m’ont ouvert les yeux. Le premier, alors que je saisissais l’un de mes élèves à la gorge parce qu’il me narguait en terrorisant les plus faibles, me permit de voir défiler un à un tous les moments où mon père m’imposait ses débordements violents, ses humiliations verbales. Moi qui croyais m’être affranchi de ce despote familial, je lui ressemblais : contre mon gré, j’étais mu par la même violence intérieure qui m’avait blessé et que je refusais. Rude désillusion : mes études, mes préparations de cours étaient un leurre. Cette réalité scolaire particulière mettait au défi ma revendication de liberté et de maîtrise.
Un second tsunami me fut nécessaire : la naissance de mon fils Arnaud qui s’éteignit au bout de quinze jours. Je devais me soumettre à l’évidence : je ne contrôlais rien. Plus question de m’appuyer sur ma petite personne, sur mes prétendues qualités de prof ou de psy. Tout volait en éclats. Je n’étais plus rien.
À l’évidence, ces épreuves étaient nécessaires pour que je puisse enfin apercevoir combien, alors que je me pensais libre et autonome, j’étais esclave de mes croyances. Le choix était simple : me résigner et nourrir une révolte contre tout et tous. Ou consentir à ces événements non choisis, et peu à peu me laisser enseigner par eux. Je ne savais pas aimer, pas plus mon fils défunt que ma propre personne, ou autrui à travers mes élèves ou mes patients. Il me fallait apprendre à aimer ma fragilité, ma vulnérabilité. Faute de quoi, je me condamnais à entretenir la conviction que je n’étais pas aimé, que j’étais sans valeur.
Mon ascension intérieure, initiée par de fracassantes épreuves extérieures, se prolongea grâce à la découverte de la psychanalyse corporelle. Mon parcours en psychanalyse verbale m’avait conduit, en définitive, à me fuir, à éviter de me rencontrer en intimité ; cette autre forme de psychanalyse m’offrit enfin la grâce de rencontrer un petit Jean-Luc sacrément abîmé. Jusque-là, j’avais peur de la souffrance et je me contentais de me la représenter. Désormais, il s’agissait de la revivre, de la prendre à bras-le-corps, de la ressentir dans toute son horreur. Conversion du regard et du cœur exigée et garantie.
Pour lire l’article en entier REFLETS n° 33 pages47 à 49


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

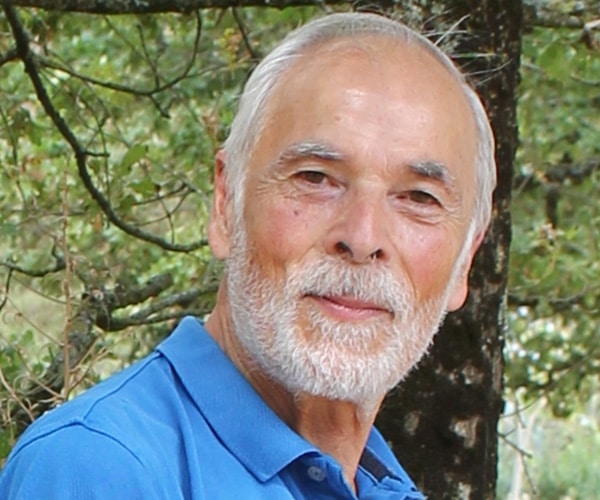
La crise de la quarantaine est le plus souvent inaperçue ou perçue comme négative. Pourtant


Voici un inédit de Gitta Mallasz sur le jeu publié seulement dans les Cahiers
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.