

Témoignage crise de la quarantaine …
Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

Il se passionne et devient un spécialiste des écosystèmes du Grand Nord et de leur préservation. Guide polaire il effectue de nombreuses expéditions en Scandinavie, au Groenland, en Alaska, au Spitzberg, en terre d’Ellesmere. Il fonde en 2008 l’association Les Robinsons des glaces réalisant des expéditions de dérive volontaire sur la banquise en vue de sensibiliser le public aux conséquences du réchauffement climatique. Il lance la proposition « Hans, l’île universelle » (rocher polaire que le Canada et le Danemark se disputent) visant à faire d’une île perdue au milieu des glaces un symbole de responsabilité
planétaire et un repère de conscience pour l’humanité.
feuilleter un atlas, c’est déjà voyager. Privativement, mais avec l’idée, peut-être, un jour, d’inscrire le voyage dans le réel, de lui donner corps en acceptant de s’ajuster à ce qui advient. Bien vite, j’associais au voyage non pas des destinations touristiques, des monuments « à voir », mais les territoires les moins prisés de la planète, où la nature s’étend à ciel ouvert. Le voyage, d’ailleurs, me paraissait une forme un peu faible, et je crois qu’il ne m’a jamais intéressé en lui-même. Je lui préférais la notion exaltante d’aventure. L’aventure, pour moi, c’était la vie, tendue par la volonté, qui s’offre au monde et à ses secrets ; le désir de découvrir, de s’exposer, de se former. Prendre un sac à dos pour calmer ce besoin intransigeant de vivre qui tenaille le cœur épris.
et nous n’étions pas nombreux à suivre cette voie. Le catalogue faisait rêver quelques sportifs et des poètes plus que les foules : il fallait « aimer le
froid », disait-on. Je l’ai toujours détesté. C’est bien pour cela que je l’ai choisi : puisque c’est l’aventure qui me tentait, je devais me mettre à l’épreuve, en commençant par vérifier si j’étais capable de surmonter ce qui me terrifiait.
Manifestement, oui… au prix d’une jeunesse qui ne connut le soleil que pour sa lumière, jamais pour sa chaleur. Au Spitzberg, au Groenland, en Alaska, dans l’Arctique canadien, où je naviguais en totale autonomie avec un simple kayak, je pensais être le jeune homme
le plus fortuné au monde, mais aussi, par la force des choses, l’un des plus courageux. Au début, je ne me rendais pas compte qu’il s’agissait
« d’aventure ». Je l’ai compris au contact de mes collègues, rares bien sûr, mais que je finissais toujours par croiser sur le terrain. Nous nous rencontrions aussi à Paris, lors de petits événements associatifs ou privés dont Sylvain Tesson, déjà célèbre entre nous avant qu’il
ne le soit de tout le pays, était souvent le complice ; nous nous retrouvions à Transboréal, la maison d’édition des écrivains voyageurs, et profitions en invités des festivités organisées partout en France autour de l’aventure : Albertville, Saint-Malo, Dijon, Toulouse,
Vernon… Quand nous ne présentions pas un film, c’était un livre. L’aventure nous rapprochait. L’on connaissait les rêves des autres : c’était les mêmes. Sauf qu’ils les entraînaient autre part.
mes pays de prédilection étant pratiquement inaccessibles six mois dans l’année, je passais mon temps à écrire. Mes aventures, je ne cherchais pas à les raconter, mais à les comprendre.
Je voulais savoir pourquoi nous étions si peu nombreux à ne pas nous satisfaire du voyage, à toujours vouloir nous confronter à quelque chose, hors des liens et des habitudes ; comprendre ce que signifiaient ces appétits géographiques, et à quelles transformations était voué ce que nous leur sacrifions.
marquées par la rencontre avec les travaux d’un philologue allemand 1, que l’histoire du monde, à travers le rôle que l’aventure a pu y jouer, m’est apparue distinctement. Beaucoup ne voyaient dans leurs périples lointains que des motifs de satisfaction personnelle ; les plus impliqués, les plus lucides sur le sens de ce qu’ils entreprenaient, devenant néanmoins auteurs, journalistes de guerre ou grands reporters. Mais je comprenais désormais que si notre pauvre monde devait être sauvé, il le serait par l’aventurier.
Le mot « aventure » a pris son sens positif moderne au XIIe siècle ; l’œuvre de Chrétien de Troyes en témoigne. Le premier roman de l’histoire de la littérature française est donc un roman d’aventures. Ce roman n’est pas qu’une succession de péripéties imaginées pour distraire, tant s’en faut. Le poète champenois cherchait avant tout à témoigner de son propre temps et à offrir aux jeunes gens de la noblesse un exemple à suivre. Ses récits sont puissamment symboliques et initiatiques.
Si cet article vous plaît, pensez à faire un don.
Le fonctionnement du site a un coût. Il n’y a pas de publicité.
Vous avez un bouton « don » sur le côté.
Merci de votre participation quel que soit le montant.
Ils cherchent l’infini dans un monde fini. Ils se mettent à l’épreuve à travers le choix d’une aventure qui les confrontera à eux-mêmes de manière à identifier leurs failles, pour les corriger et devenir chaque matin plus digne d’aimer, d’être aimé, et de servir. Le chevalier accompli est l’homme qui s’est trouvé et nous invite à nous engager, à notre tour, sur notre véritable chemin.
À l’époque courtoise, l’aventure n’est plus synonyme de hasard. L’individu qui la choisit le fait avec une intention précise. Même si, sur
la route, il est seul, tout le relie au monde. Il recherche la clarté, la droiture en lui-même, et dont ses manières et paroles rendent à chaque
instant témoignage. Il souhaite plaire à l’aimée, et mériter ses regards. Il se veut à la fois dans le monde et à l’extérieur du monde, dans un entre ciel et terre où l’être trouve sa juste place. Il n’est plus le chevalier sans culture et volontiers mercenaire ; le chevalier courtois sait que le véritable combat est intérieur. Il sait que la finalité de sa quête est subtile, et que le Saint Graal recueille le sang du Christ.
Le chevalier des XIe et XIIe siècles n’est-il pas l’ancêtre des aventuriers d’aujourd’hui ?

Retrouvez cet article dans son numéro de parution


Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

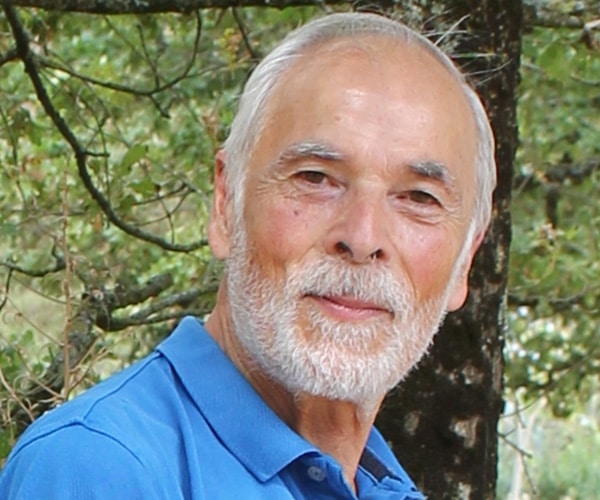
La crise de la quarantaine est le plus souvent inaperçue ou perçue comme négative. Pourtant


Voici un inédit de Gitta Mallasz sur le jeu publié seulement dans les Cahiers
La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.
Révélez votre génialité
REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :
Et cela sans avoir :
De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.
De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.